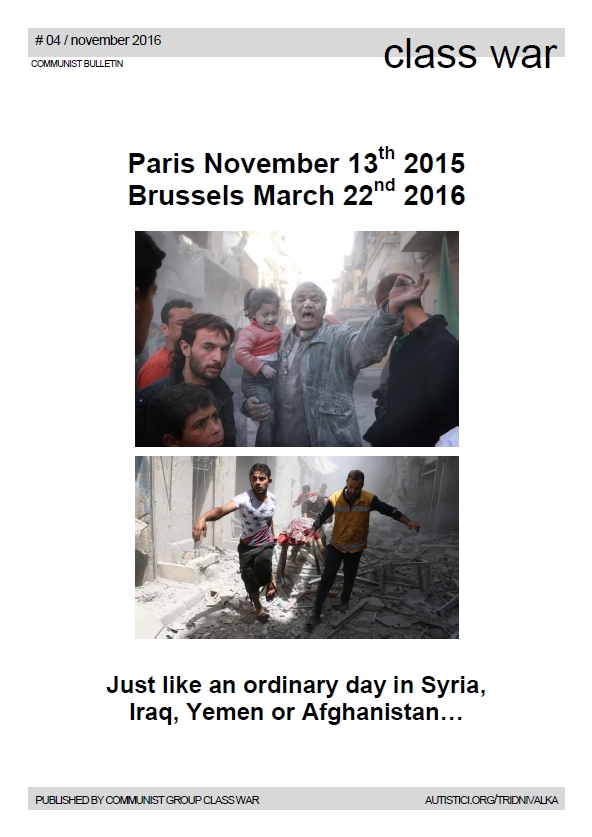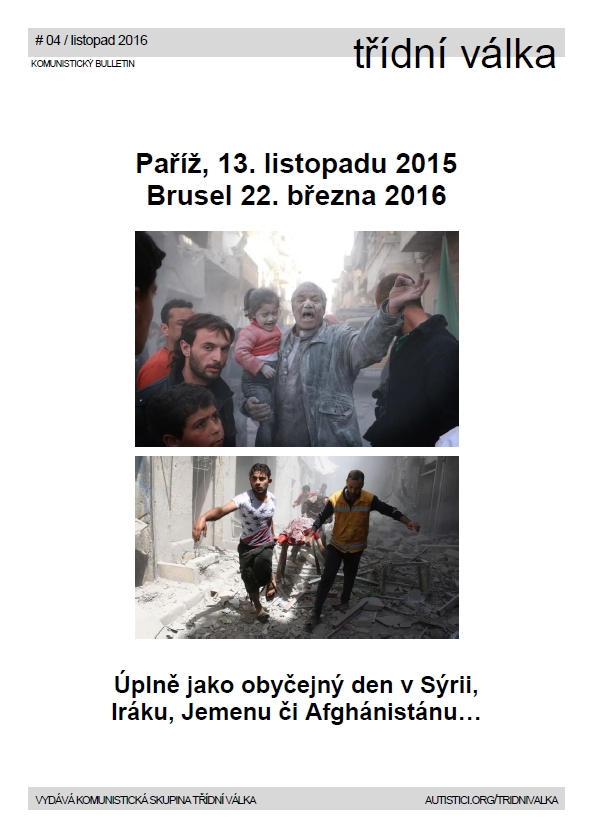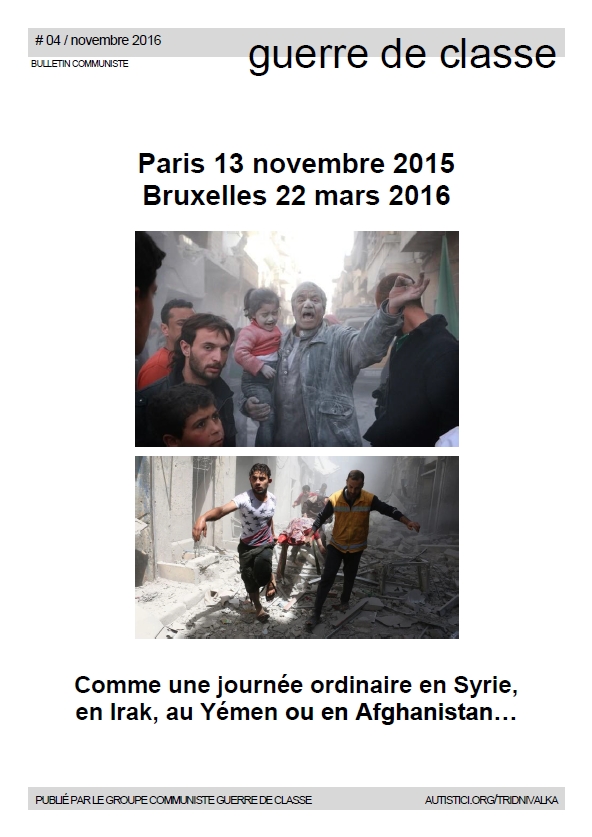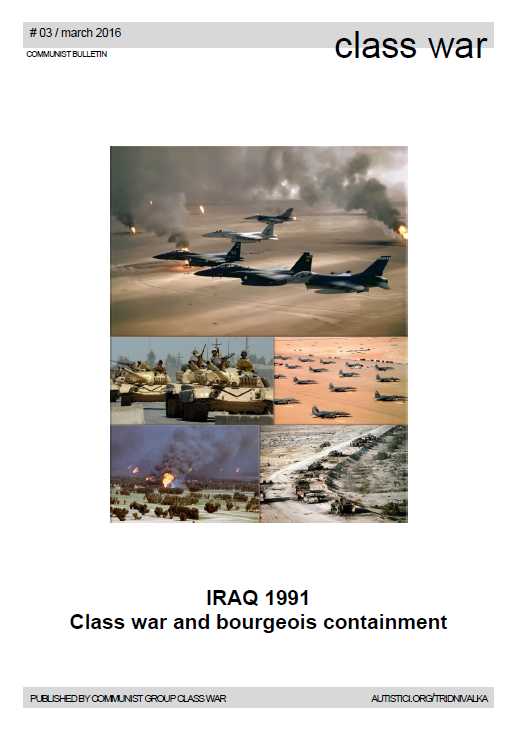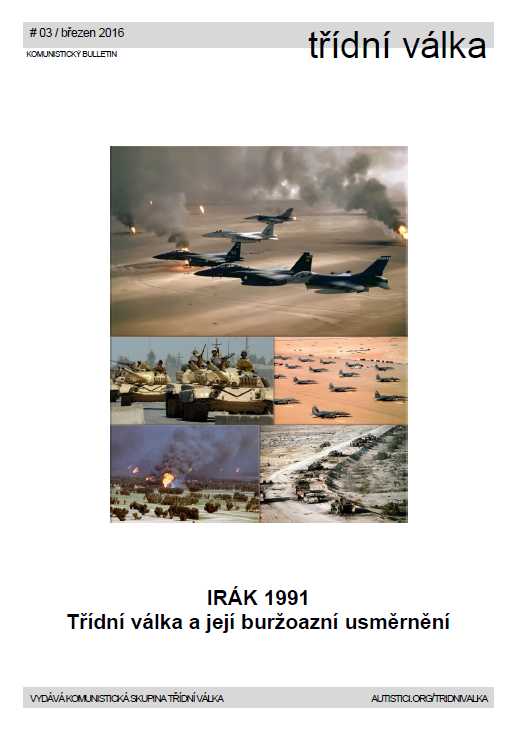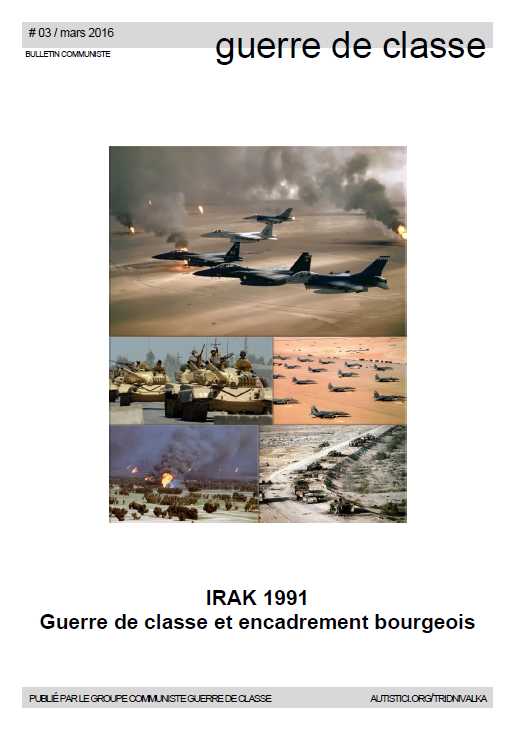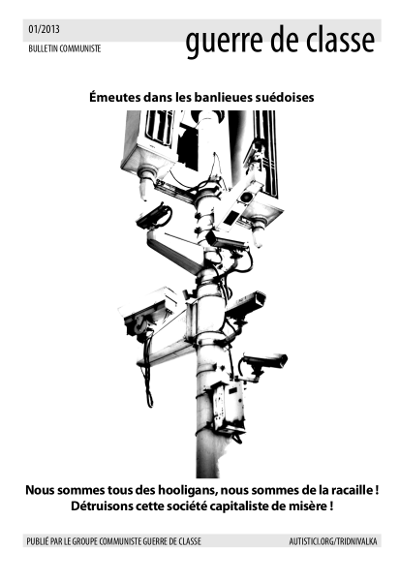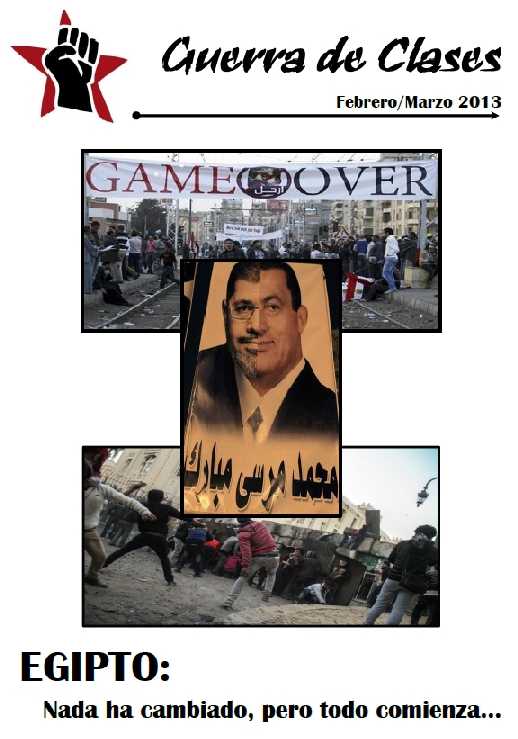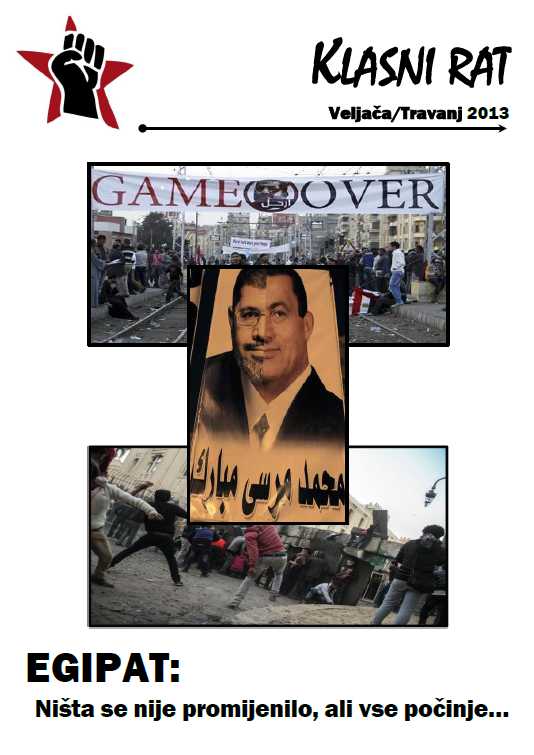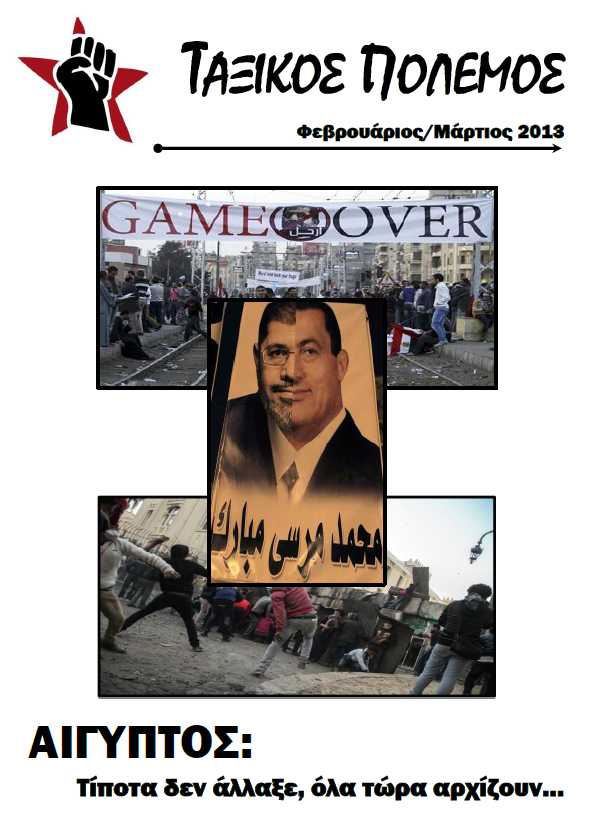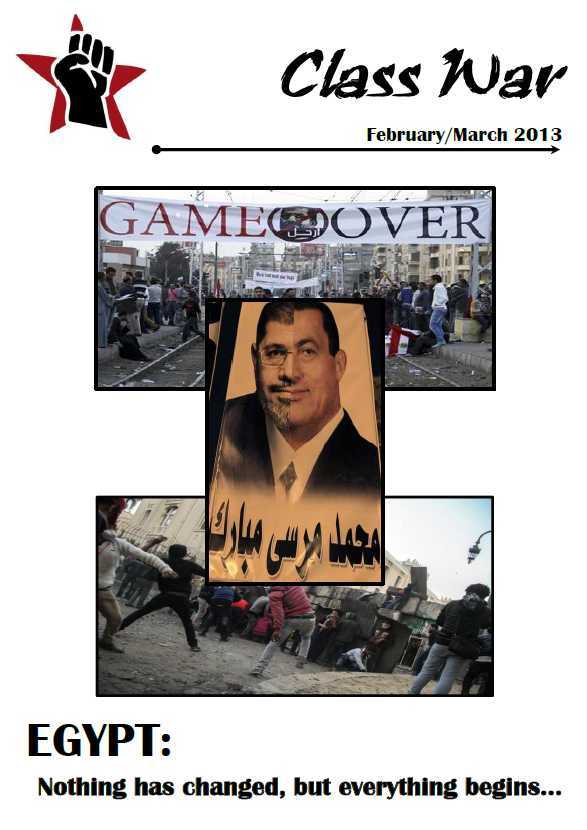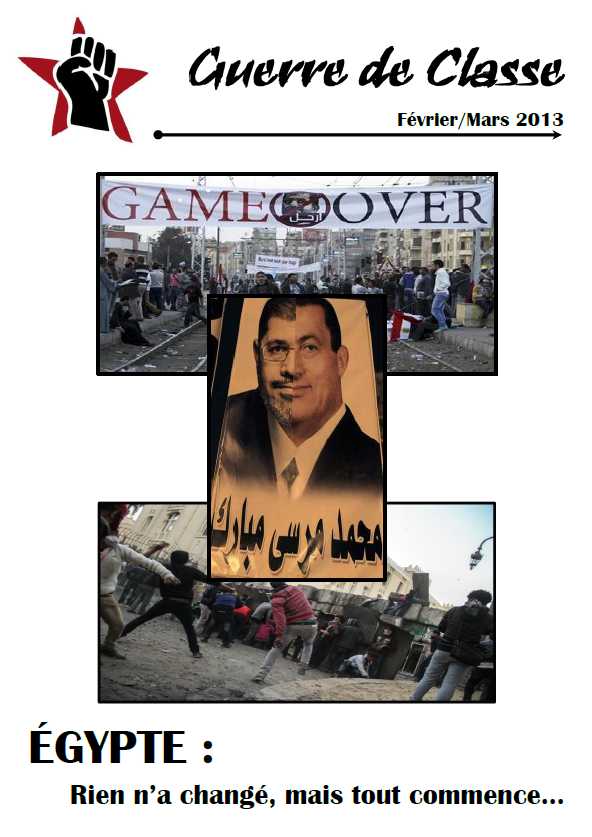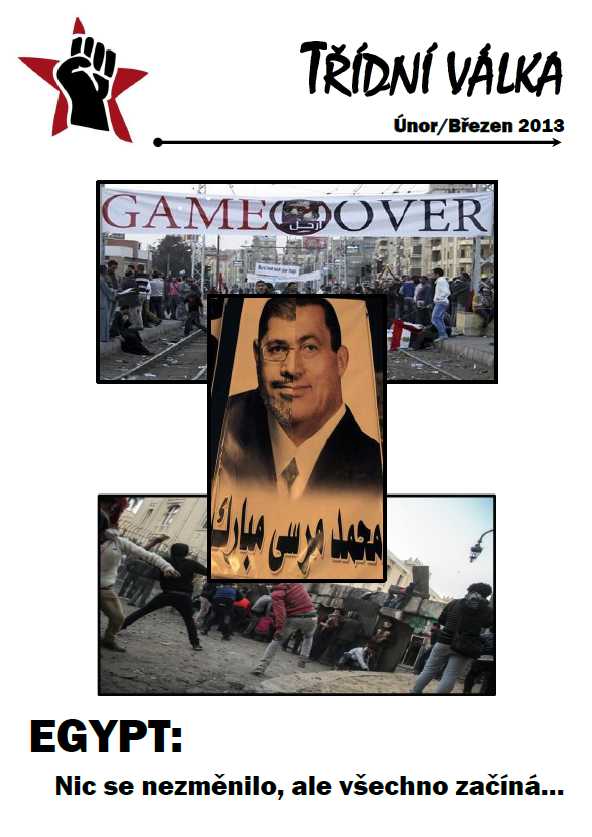| Čeština | English | Français |
| Čeština | English | Français |
La télévision nationale cubaine vient d’annoncer ce 26 novembre 2016 la mort de Fidel Castro, décédé à l’âge « vénérable » de 90 ans. Cette vieille baderne contre-révolutionnaire sera célébrée tant à Cuba, où un deuil national de neuf jours est décrété, que dans le monde entier par la gauche internationale bourgeoise, la bourgeoisie de gauche et d’extrême-gauche.
Nous apportons ici notre petite pierre à l’édifice de la critique communiste en reproduisant un texte (que nous avons également traduit en anglais et en tchèque) publié dans les années 1990 dans la revue centrale du Groupe Communiste Internationaliste (GCI) qui dénonce la nature et le caractère éminemment contre-révolutionnaire du Parti « Communiste » Cubain, des « barbudos », et de son « Lider Maximo » : Fidel Castro…
Nous tenons par la même occasion à réaffirmer qu’il n’y a jamais eu de « pays communistes » dans le monde et dans l’histoire. Tant l’URSS que ses pays satellites d’Europe de l’Est, la Chine ou le Vietnam, l’Albanie ou le Nicaragua, la Corée du Nord ou le Kampuchéa, et aujourd’hui même le Venezuela, la Bolivie, l’Equateur et le Rojava, n’ont jamais fait que représenter et représentent encore au début de ce 21ème siècle le mythe grossier du « socialisme dans un seul pays », cher aux marxistes-léninistes et aux staliniens de tous poils. Tous sont capitalistes de bout en bout ! Car là où il y a du travail salarié, il y a inévitablement aussi le Capital et il ne peut en être autrement juste parce qu’il y a aussi un costume idéologique « marxiste », une réorganisation de la bourgeoisie à travers un parti politique et un État et ses efforts (sans aucune chance durable de réussir) pour donner une autre forme aux lois capitalistes du marché, de la compétition et de la valeur.
#
Après avoir lu le second texte que nous présentons ici, « Lettre à des amis ‘rojavistes’ », certains diront qu’il n’apporte rien de nouveau au débat. C’est possible. Mais de notre point de vue, il représente un excellent résumé de l’argumentaire développé jusqu’à présent. Publié en mai 2016 sous la signature de TKGV, il a attiré notre attention en raison de son raisonnement clair et de son point de vue critique bien structuré envers le soutien actuellement à la mode de la « région autonome du Rojava ». Comme nous partageons les positions qui y sontdéveloppées, et comme ce n’est ni le premier texte critique que nous publions sur cette question, ni la première introduction que nous écrivons à ce sujet, il n’est probablement pas nécessaire d’expliquer plus avant notre position. Nous renvoyons nos lecteurs à des contributions antérieures sur notre blog qui leur donneront une idée plus complexe de la problématique.
Au lieu de cela, nous voudrions mettre en question deux points du texte, deux thèmes liés à la « question du Rojava », mais plus généraux et donc d’une certaine manière plus importants.
Le premier concerne les « amis rojavistes », c’est-à-dire ceux à qui la lettre est adressée. Les auteurs présupposent qu’il y a dans le mouvement révolutionnaire quelques groupes ou militants qui se trompent sur la question du Rojava, tandis que sur d’autres questions leurs positions restent communistes/anarchistes.
Eh bien, ce n’est pas exactement ce que nous pouvons voir autour de nous. En réalité, la plupart de ces groupes ou individus qui soutiennent le Rojava ne sont ni mal informés ni ne se trompent dans leur évaluation de cette question particulière. Au contraire, leur soutien au Rojava se conforme à la logique de leurs positions dans son ensemble. C’est leur incompréhension des questions essentielles du mouvement révolutionnaire – qu’est-ce que le Capital et l’Etat et donc quel est le but de la révolution – qui les fait soutenir le projet du Rojava.
Dans le corpus idéologique de la plupart de ces « amis rojavistes » (les quelques exceptions nous excuseront), l’Etat est au mieux l’équivalent d’un État national moderne plutôt que la façon dont le capital s’organise en force, ce qui leur permet évidemment de décrire le Rojava comme un non-Etat. La démocratie est associée à la façon dont le « peuple » peut participer à la prise de décision (et donc le problème est que notre société n’est « pas assez démocratique ») plutôt que la façon dont le capital nous rend aliénés à nous-mêmes par le biais d’une fausse communauté de citoyens, ce qui permet aux partisans du Rojava d’admirer la « démocratie participative » en tant que modèle pour la société future. Et nous pourrions continuer à n’en plus finir…
Le second point que nous aimerions faire valoir, c’est la remarque des auteurs selon laquelle « il n’y a pas que la révolution dans la vie », et qu’il y aurait des cas échappant à la logique de la compréhension communiste du monde, des événements où nous ne pouvons faire qu’un choix citoyen entre ce qui est « mal » et ce qui est « moins mal », où nous devons accepter la logique du capital, prendre part à son jeu dans l’un ou l’autre camp.
Camarades, de quels cas parlez-vous ? Ne nous faisons pas d’illusions ! Comme le capital contrôle la totalité de nos vies – en commençant par la manière dont nous gagnons notre vie, et jusqu’à nos relations intimes – il n’y a rien où nous puissions nous échapper du double rôle que nous jouons dans son jeu : le rôle de ses esclaves condamnés à nourrir son maudit profit avec notre chair et notre sang d’une part, mais aussi d’autre part le rôle de ses fossoyeurs, ceux qui le détruiront à travers l’abolition du travail salarié et en établissant une vraie communauté humaine.
En tant qu’individus, prolétaires, ouvriers et groupes, nous sommes en effet confrontés à des situations, dans des luttes locales ou internationales parfois étiquetées écologistes, syndicalistes, humanitaires ou encore autrement, où nous nous demandons comment agir, comment nous positionner, qui ou ce qui doit être soutenu, ce qu’on doit faire ? Et malgré que notre réponse puisse varier dans les détails concrets selon tel ou tel cas particulier, l’essence est toujours la même. Nous ne sommes ni dans le camp des pauvres, ni dans celui des opprimés ou des prolétaires en tant que tels. Nous soutenons toujours la tendance communiste, quelque faible, confuse, cachée ou indicible que puisse être son expression dans telle ou telle lutte, nous essayons de la soutenir, de la développer, de la pousser jusqu’à ses ultimes conséquences… Partout où les prolétaires luttent pour de meilleures conditions de vie, pour la diminution de l’exploitation, partout où ils essaient de faire valoir leurs revendications réelles et de s’organiser en dehors et contre les structures du capital…
* Guerre de Classe – Décembre 2016 *
o O o
Contre-révolutionnaires d’hier, d’aujourd’hui et de toujours : le Parti « Communiste » cubain, avec Machado, Batista, Castro
(Groupe Communiste Internationaliste – 1996)
L’action contre-révolutionnaire du Parti « Communiste » cubain, le parti unique du régime castriste, ne commence pas au moment où Fidel Castro se proclame « marxiste-léniniste ». Dès 1923, il fonctionne en tant que « Regroupement Communiste » aux ordres du stalinisme international. Comme toujours et partout dans le monde, à chaque moment décisif, ces « marxistes-léninistes » se sont situés contre les intérêts tant immédiats qu’historiques du prolétariat. A Cuba, il y a trois moments décisifs où la dictature générale du capital a concentré sa tyrannie contre le prolétariat et où le terrorisme d’Etat a atteint un niveau extrême : sous Machado, sous Batista et sous Castro. Et à chaque fois, les « marxistes-léninistes » cubains ont abandonné les luttes ouvrières et se sont mis aux ordres du tyran de service.
L’absolutisme de Gerardo Machado y Morales se caractérise par la persécution, l’emprisonnement et l’assassinat de militants ouvriers comme Alfredo López (secrétaire de la Fondation Ouvrière de La Havane), Enrique Varona, Duménico, Cúxar,… Contre cette tyrannie, la classe ouvrière lance une gigantesque bataille dont le moment culminant sera la grève générale déclenchée le 28 juillet 1933 et qui se généralise immédiatement à l’ensemble du pays. Le 7 août, en plein milieu de cette bataille, les staliniens, en échange de la légalisation du parti « communiste » et de leurs organismes syndicaux par Machado lui-même, donnent l’ordre de reprendre le travail. Les documents signés par le stalinien Cesar Villar au nom de la Confédération Nationale Ouvrière de Cuba (agence de la Confédération Syndicale Latino-Américaine de Montevideo) seront affichés par la police de Machado elle-même sur les colonnes des édifices, les lampadaires et sur les arbres dans les parcs des différentes villes. En dépit des appels au calme, la grève et l’action directe se poursuivent et, le 12 août, alors que le pays est au bord de la guerre civile, Machado prend la fuite accompagné de plusieurs membres éminents de son entourage : des ministres, des hauts fonctionnaires de la police et des chefs militaires responsables directs de la répression. Précisons que durant ses 8 années de tyrannie, Machado a pu compter sur le soutien de l’Amérique du Nord, et qu’au plus fort de la grève, l’île fut encerclée par des cuirassés nord-américains. Mais, comme cela s’est passé en d’autres occasions, le gouvernement américain décida rapidement de changer de cap, et Sumners Wells, l’envoyé de Roosevelt, prit soudainement fait et cause pour l’opposition démocratique, une formule de rechange qui finit par s’imposer.
Un peu plus tard, c’est face à Batista que les staliniens s’agenouillent. Celui-ci permet d’abord à Juan Martinello d’organiser le Parti de l’Union Révolutionnaire en échange d’une collaboration secrète. Ensuite, il autorise la sortie du journal stalinien Hoy. En 1938, le Parti « Communiste » déclare en séance plénière que Batista « n’est plus le point focal de la réaction mais le défenseur de la démocratie ». C’est le résultat de la stratégie stalinienne internationale de Front Populaire appliquée ouvertement dans l’île. Suite à cette déclaration, Blas Roca (déjà secrétaire du Parti « Communiste » Cubain) et Batista se rencontrent ; en septembre 1938, ce dernier légalise le « communisme ». Le Parti de l’Union Révolutionnaire, dont la raison d’être disparaît, se dissout au bénéfice du « communisme » et, pour effacer aux yeux du prolétariat sa collaboration totale avec les différents dictateurs, il décide de changer de nom et devient le PSP : Parti Socialiste Populaire. Lors de la campagne électorale de 1940, Batista bénéficie du soutien inconditionnel des staliniens cubains qui appliquent à la lettre la politique de Front Populaire dictée par Moscou ; en échange de quoi certains de ces staliniens, tel Juan Marinello et Carlos Rafael Rodríguez, seront (déjà) nommés ministres.
Avant les élections de 1940, la position des staliniens cubains était la suivante : « Fulgienco Batista y Zaldívar, cubain à 100 pour 100, défenseur jaloux de la libre patrie, tribun éloquent et populaire… autorité de notre politique nationale, idole d’un peuple qui pense et veille à son bien-être… homme qui incarne les idéaux sacrés d’un Cuba nouveau et qui, par son action démocrate, s’identifie aux nécessités du peuple, recèle en lui-même le sceau de sa valeur. » Il faut savoir que ceux qui chantent à ce moment-là les louanges de Batista (les Blas Roca, Carlo Rafael Rodrígues, etc.) encenseront plus tard Fidel Castro et deviendront ses ministres. Le 28 janvier 1941, Blas Roca écrit : « Nous resterons fidèles à la plate-forme de Batista dans son entièreté. » Et quelques jours plus tard, c’est Juan Marinello qui déclare : « Les seuls hommes loyaux à la plate-forme de Batista sont ceux qui militent au sein de l’Union Révolutionnaire Communiste. » Mais cet amour entre les staliniens et le dictateur Fulgencio n’est pas à sens unique. Le militaire sait reconnaître les extraordinaires services rendus par le Front Populaire. Ainsi, Batista dira par exemple : « Cher Blas… je suis heureux de te ratifier ma conviction sur l’efficace et loyale coopération que mon gouvernement a reçu et vient encore de recevoir de la part du Parti Socialiste Populaire, de ses dirigeants et de ses masses. »
Le Parti Socialiste Populaire, légalisé et reconnu comme parti syndical de l’Etat, dispose maintenant de toutes sortes de moyens et se développe de façon spectaculaire. Batista lui permet, pour la première fois en toute légalité, de publier un journal, de se doter de tous les mécanismes légaux pour contrôler le mouvement ouvrier, d’élire des sénateurs, des députés et des dizaines de fonctionnaires municipaux, d’avoir une présence permanente dans toutes les instances officielles de publicité et même de faire partie du Cabinet. Cela fait du PSP une force nationale de première importance : le nombre d’affiliés au parti passe de 2.800 en janvier 1938 à 5.000 en septembre de la même année puis à 23.000 en janvier 1939.
Les staliniens cubains soutiendront jusqu’au bout la dictature bourgeoise centralisée par Batista, et plus tard, ce sont eux qui fourniront les cadres fondamentaux de la réorganisation étatique castriste. Le 12 avril 1958, lorsque celui qui va devenir le prochain tyran, Fidel Castro, ordonne la grève générale contre Batista, elle n’est pas suivie. La CTC (Centrale des Travailleurs Cubains) dirigée par les staliniens l’interdit et invoque les mêmes arguments que ceux utilisés quelques années plus tôt pour liquider la grève de 1933, grève qui avait abouti à la chute de Machado. Les fonctionnaires staliniens qui travaillent dans l’appareil étatique de Batista continuent à assumer leurs fonctions et restent sourds aux appels de Fidel Castro qu’ils qualifient d’aventurier petit-bourgeois. Au même moment, les Nouvelles de Moscou affirment que les insurrections armées ne sont que des étincelles et qu’elles n’affaiblissent en rien le pouvoir de Batista. Le Mouvement du 26 juillet (1958) lui-même condamnera, en août de la même année, la « trahison » du Parti Socialiste Populaire. Mais, une fois le « linge sale » des trahisons lavé en famille, tout le monde se réconcilie à l’ombre de Castro et on enterre l’histoire des désaccords passés sous toutes sortes de mensonges ou de contre-vérités, le XXème congrès du Parti « Communiste » d’Union Soviétique allant jusqu’à déclarer que « les communistes cubains étaient en premières lignes du combat » (déclaration de Severo Aguirre).
Ce n’est que lorsque la chute de Batista devient évidente et imminente, à la fin de l’année 1958, que les staliniens cubains se décident à jouer sur les deux tableaux. C’est ainsi que Carlos Rafael Rodrígues, ministre de Batista de 1940 à 1944 et ministre sans portefeuille pendant toute la dictature de Batista, se rend à la Sierra Maestra pour conclure un accord officiel avec Fidel Castro, un accord qui préfigure tous ceux qui suivront et fait de ce même C.R. Rodrígues un personnage décisif du régime castriste. Dès lors, l’un des premiers actes gouvernementaux de Fidel Castro sera, le 10 janvier 1959, de légaliser à nouveau le Parti Socialiste Populaire. Nous n’allons pas ici analyser les innombrables luttes internes entre fractions au sein du PSP, les différentes purges, nous n’allons pas non plus examiner les nombreuses oscillations et revirements qui amenèrent Fidel Castro, viscéralement anti-communiste et formellement opposé au PSP, à se soumettre entièrement aux diktats du Parti de Moscou.
A titre de rappel pour les lecteurs qui n’ont aucune idée de la trajectoire de Fidel Castro, rappelons simplement qu’il était un fervent admirateur et un membre du parti « orthodoxe »d’Eduardo Chibás, ennemi implacable du PSP. Dans la citation qui suit, il traite d’ennemis et de traîtres ceux qui seront sous peu ses plus proches collaborateurs au sein du gouvernement et du Parti « communiste ».
Castro dit de Blas Roca qu’il est : « Notre Daladier », et il ajoute : « il change de nom comme de couleur politique et il change plus de ligne tactique que de chemise. C’est un caméléon politique. Un jour, il attaque le militarisme, le lendemain, il le défend… » Il n’hésite donc pas à traiter l’ensemble du parti, et son futur collaborateur Blas Roca, de traîtres à la cause du prolétariat : « Ceux qui claironnent leur gauchisme et leur amour du peuple… tournent le dos aux travailleurs et se placent humblement aux ordres de la botte militaire de Batista… Personne ne peut m’empêcher de leur crier la vérité à la figure à ces profiteurs marchands du prolétariat… » Et ils ne cesseront pas d’être des « marchands du prolétariat » quand ils se mettront sous la coupe de Fidel Castro.
Au contraire, ce sont les Blas Roca, Carlos Rafael Rodrígues,… et y compris Anibal Escalante, ce « communiste moscovite » qui avait comploté depuis toujours contre le régime de Castro, c’est-à-dire en fin de compte, la totalité du parti, qui finit, malgré les apparences, par faire de Fidel Castro un véritable vassal de Moscou, un « marchand du prolétariat » supplémentaire.
Pour terminer, voici la déclaration que fit Fidel Castro (peu après son fameux plaidoyer « L’histoire me donnera l’absolution »), alors qu’il était détenu au Mexique sur les instances de la police de Batista qui l’accusait d’être membre du « parti communiste » : « … Quel sens moral a-t-il, par contre, monsieur Batista, pour parler de communisme alors qu’il fut candidat à la présidence du Parti Communiste aux élections de 1940, alors que ses affiches électorales s’abritaient sous la faucille et le marteau, alors que sur les photos il se promène avec Blas Roca et Lázaro Peña, alors qu’une demi-douzaine de ses ministres actuels et de ses collaborateurs de confiance furent des membres importants du Parti Communiste ? »
Tels sont les antécédents fondamentaux de ce mariage historique qui a fait du parti « communiste », le parti fondamental de l’Etat capitaliste cubain.
o O o
Lettre à des amis « rojavistes »
(TKGV – Mai 2016)
« Pourtant, assez vite, au fil de mes années d’apprentissage de la vie et de la révolte, à travers de rares informations, des signaux inquiétants arrivaient aussi de là-bas. »
Ngo Van
Cette lettre ne s’adresse pas aux militants qui surfent d’un mouvement à une lutte en fonction du sens des médias pour construire un parti ou une orga. Elle s’adresse à vous, amis et camarades de différentes villes dont nous apprécions les réflexions et le sens critique et partageons souvent les positions, mais avec qui nous pouvons parfois être en désaccord[1].
C’est en particulier le cas à propos du Rojava. Contrairement à vous, et depuis un an et demi, nous avons plus que des doutes sur l’utilisation du mot « révolution » pour qualifier ce qui se passe dans cette région. Des doutes également concernant la manière dont ce « processus » est présenté et soutenu en Occident.
Cette lettre n’a pas pour objectif d’être exhaustive sur la question, ni de « dézinguer » vos positions ou d’essayer de vous convaincre (surtout pas en alignant des sources et références dont vous disposez aussi, mais dont nous faisons une lecture différente, ni en usant des exemples de la Russie de 1917 ou de l’Espagne de 1936). Il s’agit plutôt de lancer des perches et pistes pour un débat, d’éviter que certains ne s’enferment et s’enlisent dans une guerre de positions qui serait regrettable.
Ce qui nous semble être ici en jeu, en question, c’est le regard que nous portons sur un mouvement ou une situation, la manière dont nous les jugeons et les traitons, entre distance d’analyse et distance géographique, entre discours et situation concrète. Tout comme notre engagement dans des luttes immédiates (toujours partielles, souvent réformistes ou défensives), le positionnement sur ce qui se passe à des milliers de km ne doit pas dépendre d’une quelconque norme ou « pureté » révolutionnaire, ni de l’application de modèles préétablis[2]. Nous n’avons pas à rejeter tel ou tel mouvement parce qu’il ne paraîtrait pas assez radical, mais à interroger son contenu et notamment du point de vue des rapports de classes.
L’expérience au Rojava n’a pas à être traitée différemment. Comme toute situation sociale dans ce monde capitaliste, elle est traversée par des contradictions de classes. Bien qu’il soit difficile de les mesurer, d’en connaître exactement les dynamiques et les acteurs, des questions s’imposent : Quelles-sont les transformations en cours ? Où se cristallisent les contradictions, quels acteurs sont à l’œuvre ? Quels-sont les rapports de forces qui se sont constitués ? Quel écart entre les discours et les intérêts réels ? Entre nos désirs de révolution et les limites qu’ils rencontrent ? Quid du prolétariat ? Quelle est notre vision de la révolution ? Etc.
Seuls contre tous ?
L’« expérience révolutionnaire » du Rojava est souvent présentée comme devant faire face à l’hostilité générale et aux menaces des armées impérialistes et « fascistes » de la région, sinon de la planète.
Rappelons tout d’abord l’accord de non-agression qui fait que depuis 2012 les forces armées du Rojava et celles de Damas voisinent pacifiquement (sauf rares accrochages), voire parfois collaborent tactiquement (Al-Hasakah en 2015, Alep et corridor d’Azaz en 2016), mais aussi la quasi co-administration de certains secteurs (Al-Hasakah ou Qamichli). Une entente qui nourrit bien des débats et polémiques.
En 2014, des militants révolutionnaires ont manifesté en France pour que les puissances militaires occidentales apportent un appui aérien aux YPG et leur livrent des armes. A cette époque, on nous proposait de collecter quelques milliers d’euro au profit des YPG, notamment pour l’achat d’armes. Depuis, les États-Unis, suivis par d’autres États, leur ont livré des tonnes d’armes et de munitions. Les militants révolutionnaires l’admettent mais reprochent aujourd’hui aux Occidentaux de ne pas fournir d’armes lourdes aux YPG[3].
Sur le terrain, la campagne militaire créant une continuité territoriale entre les cantons de Kobane et Cizîrê (d’octobre 2014 à juin 2015) a montré l’étroite collaboration entre les YPG et l’aviation occidentale (donc, inévitablement, avec des forces spéciales américaines au sol). Les YPG ont alors regroupé autour d’eux, en une alliance politique et militaire (les FDS), plusieurs groupes armés arabes dont on peut douter du caractère libertaire.
Les combats de février-mars 2016 autour du canton d’Afrin ont eux montré qu’existait a minima une coordination opérationnelle entre les YPG, l’armée loyaliste syrienne et l’aviation russe. Soit. Des groupes rebelles jusque-là alliés à Al-Nosra (branche syrienne d’Al-Qaïda) ont à cette occasion préféré rejoindre les FDS.
Avec de telles alliances, un territoire beaucoup plus vaste à gérer et une plus grande diversité de population, le « pragmatisme » du commandement kurde ne risque pas de se réduire.
En ce qui concerne le plan diplomatique, les représentantes (sic) des YPG sont régulièrement envoyées dans les pays occidentaux pour nouer des contacts. Le temps où ils étaient présentés comme totalement isolés, victimes de leur positionnement révolutionnaire (alors même que leur commandante était reçue à l’Élysée) est révolu. Leur présence aux négociations de Genève a été empêchée par les efforts de la Turquie, alors que des pays comme la Russie y étaient favorables. Le gouvernement du Rojava a d’ailleurs ouvert une représentation diplomatique à Moscou en février dernier, occasion d’une agréable petite fête (idem à Prague en avril).
D’un point de vue politique, diplomatique et militaire, la direction du PYD/YPG, courtisée tant par les États-Unis que par la Russie, a su avec opportunisme faire monter les enchères et tirer son épingle du jeu ; c’est-à-dire renforcer son poids politique en obtenant un soutien militaire et une quasi reconnaissance internationale.
Quant au soutien médiatique, il est très répandu et particulièrement positif. En France les combattants des YPG (et surtout les combattantes des YPJ) sont présentés comme des parangons de courage, de féminisme, de démocratie et de tolérance. C’est le cas d’Arte à France 2 en passant par LCP, idem à la radio où, de Radio Libertaire à Radio Courtoisie en passant par France Culture on vante les combattantes de la liberté.
Il est logique que le PYD recherche des soutiens et s’appuie sur des services de communication et de propagande efficaces, mais cela soulève néanmoins des questions. Le PYD se présente en effet au monde comme le rempart de la démocratie, un partenaire responsable, un champion de la lutte contre le terrorisme et l’islamisme. Est-ce un camouflage ? Les diplomates et militaires des pays impérialistes se font-ils savamment berner sur toute la ligne depuis des années ? L’impérialisme est-il si peu conscient de ses intérêts qu’il tolère et même soutient à Kobane un « processus révolutionnaire », même « en devenir », avec démocratie directe, « égalité » des sexes, « autogestion » des ressources, etc., toutes choses qu’il empêche évidemment à Londres, Paris ou Chicago ? N’a-t-il pas d’autres choix ?
De la Guerre ?
La résistance des kurdes dans les ruines de Kobane a ému la planète et entraîné une vague de soutien international. S’en est suivie pour les YPG, et grâce au soutien des aviations américaines ou russes, une longue série d’offensives victorieuses, permettant un contrôle kurde sur un vaste territoire.
Effervescence des combats ou volonté politique ? Les critiques que l’on fait généralement à une armée en campagne n’ont pas épargné les YPG : villages rasés, populations déplacées, habitations arabes incendiées, police peu appréciée, conscription, jeunes dont les papiers ne sont pas en règle embarqués de force à la caserne pour effectuer leur service militaire, etc. Les organisations syriennes opposées au PYD (parfois kurdes elles-aussi, généralement membre du CNS[4]) dénoncent régulièrement ses exactions et bavures. Les organisations internationales de défense des droits de l’homme en confirment certaines mais reconnaissent que, parmi les belligérants de la région, c’est bien aux militaires kurdes qu’on a le moins à reprocher ce genre d’agissements. Quant aux autorités du Rojava, elles reconnaissent une partie de ces « exactions » ou « défauts », et ont promis ou réalisé des enquêtes et des corrections (par exemple sur l’enrôlement d’enfants soldats) afin de répondre aux standards occidentaux en terme de démocratie, de Droits de l’Homme et de conduite de la guerre. La création d’une « véritable » armée a d’ailleurs été récemment annoncée (les Forces de protection autonomes, FPA).
Il nous semble difficile de voir dans ces « débordements » l’œuvre de prolétaires devant faire face aux difficultés d’une lutte concrète… ce sont plutôt les nécessités de la guerre qui expliquent les « bavures » des combattants YPG.
Nationalisme ?
La situation actuelle au Kurdistan syrien trouve ses origines dans la défaite des révoltes syriennes en 2011, dans l’évolution d’une situation régionale marquée par un chaos militaire et dans les dynamiques de partis nationalistes kurdes aux intérêts spécifiques et aux alliances contradictoires.
Le PYD, organisation kurde, est la force politique qui s’est imposée dans cette zone. Son discours n’est pas celui du nationalisme d’antan, celui du PKK ; le vocabulaire a changé. Les cadres et militants des PYD-YPG ne sont semble-t-il pas tous au courant car leurs propos sont encore très souvent teintés de ce « patriotisme » kurde, et vantent les spécificités de ce « peuple » à la culture « millénaire » et « par nature » rebelle, etc.[5]
C’est que la question du peuple et de l’identité kurde (langue, culture, histoire, coutumes, etc.) reste inséparable du projet politique du Rojava. Tout comme celle de son territoire, le Kurdistan, c’est-à-dire les zones définies comme ayant à une époque été majoritairement peuplées de kurdes. Et si les dirigeants kurdes insistent beaucoup sur la protection des minorités ethniques et religieuses (dans les discours ou le Contrat social[6]), c’est bien en tant que représentants de la majorité.
Le projet du PYD est donc présenté comme non spécifiquement kurde et pouvant, dans un second temps, s’appliquer à l’ensemble de la Syrie ou du Proche-Orient. Les YPG ont d’ailleurs conquis des zones, autour des cantons de Kobané et de Cirizé, où les Kurdes sont minoritaires ; mais des tensions entre populations arabes et militaires kurdes y demeurent.
Cette extension territoriale, mais aussi les nécessités du recrutement, de la guerre ou de la propagande, expliquent que les YPG aient intégré en leur sein des arabes, parrainé la création d’unités ethniques ou religieuses spécifiques (syriaques, yézidis) et, surtout, qu’elles se soient alliées depuis octobre 2015 avec des milices arabes (au sein des FDS).
Autorité et démocratie
Passons sur le fonctionnement du PYD, la branche syrienne du PKK connue pour son caractère autrefois autoritaire mais qui, paraît-il, a bien changé. Admettons-le pour le moment. Mais notons que ce type d’organisation qui d’ordinaire subirait les foudres des antiautoritaires, bénéficie ici d’une étrange mansuétude. Peut-être est-ce parce que le PYD annonce vouloir s’en prendre au pouvoir de l’État et qu’on assisterait à une sorte de modernisation de la vieille théorie du « dépérissement de l’État », de sa police[7] et de son armée.
Comme il le décrit lui-même, le PYD est en train de bâtir au Rojava la structure administrativo-politique d’une région autonome dont l’inspiration philosophique se trouve dans les œuvres de Murray Bookchin et l’inspiration juridique dans les traités internationaux sur les droits civils et politiques. Cette structure aurait pour vocation, à terme, de se superposer à celle de l’État syrien dont elle reconnaît la légitimité et l’intégrité des frontières.
C’est ce que proclament le Contrat social et les dirigeants du Rojava, ce dont discutent actuellement les grandes puissances et ce qui, concrètement, semble se mettre en place. Depuis 2012-2013, l’administration du Rojava se renforce et se normalise, ses structures de justice, police, armée ou formation se perfectionnent (notamment dans les cantons les plus protégés jusque-là, Cizîrê et Afrin), assurant ainsi un certain nombre de tâches jusque-là dévolues à l’État syrien.
On notera tout de même que la structure administrative mise en place au Rojava serait, en cas d’éclatement définitif de la Syrie ou de déclaration d’indépendance, quasiment celle d’un état (ne lui manquerait que la souveraineté monétaire).
Évidemment, le Rojava ce n’est pas que cela. Le mot de « révolution » ou du moins l’adjectif « révolutionnaire » a été sur beaucoup de bouches et sous beaucoup de claviers pour décrire le processus en cours dont la base est double :
- Nous avons affaire d’un côté à un mouvement populaire de révolte, de résistance, d’autodéfense et de survie dans une situation de guerre.
- De l’autre il y a la mise en œuvre du projet du PYD, qui combine en théorie pouvoir central (sur le modèle des démocraties occidentales) et auto-administration locale du quotidien par les habitants.
Reste à savoir comment s’articulent réellement les deux, et à quoi cela correspond concrètement sur le terrain[8].
Les visiteurs occidentaux n’ont pas manqué, et les témoignages enjoués se sont succédé dans les journaux militants et les blogs. On y décrit généralement :
- Une ambiance sympathique et chaleureuse avec moult détails, des discussions spontanées en toute liberté (choses rares en ce monde).
- Peu de choses sur l’économie, sinon que le bouleversement des rapports sociaux capitalistes est reporté à plus tard et que la propriété privée a été sacralisée par le Contrat social. On évoque au mieux la création de quelques coopératives agricoles[9].
- L’organigramme de fonctionnement démocratique du Rojava, tel qu’on peut le lire sur Wikipedia. Presque rien, si ce n’est un ou deux modestes exemples, sur le fonctionnement réel de ces centaines ou milliers d’assemblées populaires censées couvrir le pays dans les villages et les quartiers. Mais disons-le simplement : que dans tel quartier les habitants se réunissent chaque semaine pour discuter et décider de créer ici un potager collectif, de réparer une route ou de construire une salle de réunion, et puissent trouver soutien et financement auprès d’une administration municipale compréhensive, c’est une très bonne chose pour eux. Nous remarquons toutefois que ce n’est pas de cette manière que sont prises les décisions politiques, diplomatiques et militaires.
- L’instauration d’une égalité formelle entre hommes et femmes. Le fait que des femmes participent à des discussions et des combats, serait un choc et entraînerait d’inévitables modifications des rapports sociaux de sexe. Là aussi on peut se demander quelle-est, au-delà de la propagande (particulièrement forte sur cette question), l’ampleur réelle de ce phénomène auquel de larges pans de la société semblent échapper. Idem sur la vision peut-être caricaturale de la situation des femmes kurdes en Syrie avant 2012.
La dynamique d’une organisation étant avant tout d’assurer sa survie, son rôle et son pouvoir il serait particulièrement surprenant que le PYD ou l’administration du Rojava organisent leur propre disparition au profit d’une assemblée d’assemblées populaires.
S’il devait finalement se mettre en place dans cette région un régime démocratique s’inspirant des modèles occidentaux, mais avec une dose d’assemblées locales consultatives, ce serait une grande nouveauté pour la région, et un bien moindre mal pour ses habitants. Le PYD y serait sans doute hégémonique pour longtemps mais, avec le temps, les choses pourraient évoluer. Est-ce une vision pessimiste ou optimiste ?
Demain ?
On nous parle d’une dynamique populaire, certes engourdie par la guerre, mais pouvant ressurgir par la suite, plus tard. Il faudrait garder l’espoir, et surtout croire que l’humanité (ou le prolétariat) s’émancipera en faisant la guerre d’abord, et seulement ensuite la révolution. Ceci nous semble de la folie. C’est pourtant le choix qu’aurait fait le PYD et qui correspond au vieux schéma « révolutionnaire » (la classique phase de transition se limitant ici à une « révolution politique »).
Nous ne croyons pas que la révolution (ce grand bouleversement qui abolira la société de classes) puisse découler d’une suite de choix stratégiques à effectuer dans le bon ordre. Nous ne savons pas à quoi elle ressemblera mais, sans pour autant nier son caractère forcément violent, permettons-nous une affirmation : elle ne sera pas un affrontement militaire, une série de victoires de l’armée des prolétaires (remettant au lendemain les transformations radicales de la société) sur celle des capitalistes. La révolution n’est pas la guerre. Et si parfois les périodes de guerre peuvent entraîner une déstabilisation politique, générer tensions et décomposition sociales, tel n’est plus le cas ici, au contraire.
A moins d’user de l’acception vidée de sens et anodine qui revient à la mode, le mot de « révolution » ne nous paraît donc pas, vous l’avez compris, adapté pour décrire la situation au Rojava. Celui de « processus révolutionnaire » non plus, même s’il n’est que « potentiel »… car dans ce cas en quoi le serait-il plus ici qu’en Chine ou en Algérie ? Au Rojava c’est la guerre qui domine, guerre populaire si l’on veut, mais guerre tout de même.
La question du soutien se pose ici[10]. Et qui soutenir ? (au-delà d’un prétendu « peuple » millénaire exempt de division de classes et par nature révolutionnaire ?).
Soutenir le « mouvement » ? La « lutte » ? Le prolétariat ? Comment est-ce que cela peut se traduire concrètement ? Le plus pertinent serait, comme dans tous les cas, de lutter localement contre notre propre bourgeoisie, mais on sait ce qu’il en est. Alors, au-delà du symbole, quelle solidarité est possible à 4 000 km de distance ?
Jusqu’à présent, les militants révolutionnaires les plus impliqués et enthousiastes ont surtout vanté les mérites et les actions des YPG-YPJ, branche armée du PYD (parfois en omettant les sigles). Si il y a eu soutien, peu critique et surtout financier, c’est vers cette organisation qu’il est allé (ou éventuellement vers des structures qu’elle contrôle). Et nous croyons qu’il y a bien là un souci de taille[11].
Ce parti qui domine la scène politique de la région et prétend représenter les intérêts du « peuple » kurde est la force qui actuellement encadre la société. Il serait complètement illusoire d’espérer soutenir, au sein du PYD, telle tendance radicale contre telle autre modérée. Tout autant illusoire que de soutenir un régime dans l’espoir que l’action autonome des prolétaires le déborde.
Car vous le savez, ou l’avez compris, et pour le dire froidement : nous pensons que l’administration qui se met en place aujourd’hui dans le nord de la Syrie, assure de fait dans cette zone les tâches d’un État défaillant, préservant du chaos les fondements de la société capitaliste (valeur, salariat, classes, propriété privée, production). Demain, sur les bases qui auront été négociées entre le Rojava et les autres États, elle assurera l’ordre, gérera la population et les classes. Aussi progressiste soit-elle, c’est bien cette administration que devront alors affronter les prolétaires kurdes et arabes[12]. Les forces qui les réprimeront seront les Asayish et, s’il le faut, les YPG.
Sur cette fin peut-être un peu abrupte, mais dans l’attente de vos réactions, recevez bien des salutations.
[1] « Nous » et « vous » renvoient aussi à un ensemble flou d’organisations, groupes plus ou moins formels et individus anarchistes, libertaires, marxistes (non-bolcheviques), autonomes, etc. qui forment le « milieu » dit « radical » ou « révolutionnaire » dans lequel nous sommes peu ou prou partie prenante.
[2] Nous ne détenons pas le schéma d’un processus révolutionnaire « pur » et ne croyons ni à l’existence ni à la possibilité d’un tel schéma.
[3] Les États-Unis s’y opposent, arguant qu’elles pourraient être utilisées par le PKK contre l’armée turque.
[4] Conseil national syrien notamment soutenu par la Turquie et l’Arabie Saoudite.
[5] On serait tenté de dire que les mots n’ont peut-être pas tout à fait le même sens partout. En France ce type de discours serait au minimum qualifié de « réactionnaire ».
[6] Le Contrat social est la constitution du Rojava adoptée le 29 janvier 2014.
[7] David Graber rapporte le témoignage du directeur de l’académie de la police du Rojava, les Asayish : l’objectif à long terme serait de former chaque citoyen durant six semaines afin que le métier de policier devienne inutile.
[8] Nous passons sur une question cruciale : ce processus fait-il suite aux manifestations du printemps syrien de 2011 ou, au contraire, y a-t-il mis un terme en y substituant le projet politique du PYD descendu des montagnes après le départ des troupes d’Assad ?
[9] Le fonctionnement en autogestion d’une seule usine du Rojava aurait déjà fait l’objet de dizaines d’articles et la couverture de plusieurs journaux militants.
[10] Il n’y a pourtant pas que la révolution dans la vie. Notre point de vue nous amène certes à voir dans chaque lutte les enjeux de la lutte des classes. Mais si théoriquement c’est toujours possible, est-ce toujours nécessaire ? Il y a des « causes » qui n’ont rien de révolutionnaires, qui sont humanitaires ou humanistes mais peuvent être soutenues ; des luttes écolos ou réformistes auxquelles on devrait pouvoir participer sans honte ; des nécessités immédiates qui, parfois, peuvent trouver des réponses autres que marxistes ou anarchistes. Et ce n’est pas un drame.
[11] Nous pensons d’ailleurs que si une telle organisation faisait demain son apparition en France, avec le même programme, nous serions (vous et nous) parmi les premiers à en dénoncer le danger (et à en subir la répression).
[12] Et quid des déserteurs, insoumis au service militaire au Rojava ? Il s’en trouve, de fait, parmi les migrants qui aujourd’hui cherchent refuge en Europe. Il est peu probable qu’ils demandent du soutien à ceux qui aident l’armée qu’ils fuient ! Un site de l’opposition syrienne, également opposé au PYD, signalait à l’automne 2015 une première manifestation contre la conscription dans une ville du Rojava.